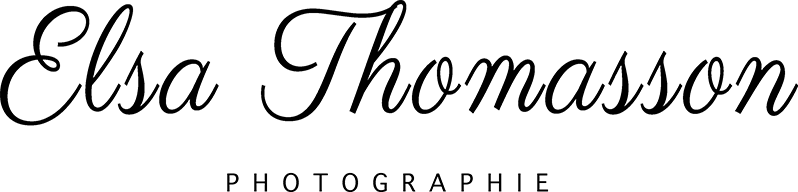Sylvie est infirmière en soin psychiatrique en milieu carcéral, un métier loin de notre quotidien.
Sylvie, quel est votre parcours, celui qui vous a mené à exercer ce métier ?
J’ai cinquante-cinq ans, et depuis plus de trente ans, je suis infirmière. J’ai d’abord commencé dans les soins généraux, puis rapidement je me suis tournée vers la psychiatrie. J’ai travaillé sur divers lieux, notamment au centre psychiatrique de la Roche sur Foron. Depuis 2003, j’ai quitté le système français pour continuer en Suisse. Actuellement je travaille en collaboration avec la prison de Champ-Dolon sur Genève. Je suis dans une unité de crise psychologique pour détenus. Nous accueillons des prisonniers qui ont besoin de soins spécifiques urgents pour des périodes de trois semaines. Les patients viennent de toutes la Suisse car ce type de structure est rare. La structure se compose de six unités; l unité de crise a seize lits. On nous envoie les patients en situation de crise psychique : décompensation de troubles mentaux, risque suicidaire…
Quels sont les profils rencontrés ?
Ce sont souvent des personnes avec des troubles mentaux préalables : troubles anxio-dépressifs, pathologie addictive, toxicomanie, psychose de délire, paranoïa, mais tous ces troubles peuvent se cumuler. Ces problèmes de comportements et d’adaptations obligent ces gens à être accompagnés pour pouvoir vivre avec les autres. Nous aidons la personne à retrouver un certain calme, une estime d’elle-même pour pouvoir retourner purger sa peine.
Quasiment tous ont un parcours de vie chaotique, avec des situations d’abandon ou de maltraitance. Cependant les psychoses peuvent tomber sur n’importe qui, quel que soit le milieu social. Mais souvent c’est le parcours des gens qui explique leur situation, il est rare qu’ils aient eu un parcours « normal ».
Il y a aussi tous les immigrés qui sont juste illégaux mais qui n’ont pas commis de crime. Je rencontre beaucoup de parcours migratoires compliqués qui ont accentué les troubles mentaux. Ils quittent des pays en guerre et ont vécu l’enfer souvent très jeune. Beaucoup présentent de lourds symptômes de stress post traumatique. Je suis particulièrement touchée par ces jeunes. Devant des chiffres on peut avoir des partis pris, mais face à un être humain c’est différent. Ils sont juste nés au mauvais endroit. Ils errent dans un No Man’land sans vrai futur possible, l’espoir y est dur à trouver. J’ai moi-même du mal à leur insuffler de l’espoir alors que je sais qu’ils vont être reconduits à la frontière. Cela me pose un conflit de conscience avec mes valeurs humaines.
Quels sont les difficultés et challenges du quotidien ?
La plus grosse difficulté c’est de faire accepter à une personne qu’elle est malade, cela peut demander du temps. Pour un psychotique qui est en crise, son délire c’est sa réalité. Un parano pense que le monde est contre lui. L’alliance avec le thérapeute est fondamentale, il faut réussir à nouer la confiance avec le patient. Nous bénéficions de formation continue, nous travaillons avec divers outils, notamment l’art-thérapie. L’idée est d’avoir une activité qui va aider à rentrer en contact pour permettre la parole. Le milieu carcéral est utile pour que la société vive en sécurité mais ces lieux ne permettent pas une réhabilitation. La prison rend les gens encore plus malades.
Par rapport à la France, le système de santé suisse reste préservé avec plus de moyens. Je ne peut pas me plaindre. Mais c’est dur d’avoir des « happy end » en psychiatrie. Les victoires sont des petites victoires, simplement permettre aux gens de retrouver un semblant de liberté, de normalité c’est déjà beaucoup.
Vous sentez-vous parfois en insécurité ?
Personnellement je ne me sens jamais en insécurité. Il y a des gardiens, des chambres d’isolement, nous ne sommes jamais seul, bien moins qu’aux urgences d’ailleurs.
Avec l’âge, j’ai appris à prendre soin de moi et être moins impactée. Je rentre fatiguée mais comme beaucoup de travailleurs. Je sais que l’agressivité des patients n’est pas dirigée contre moi personnellement. Ce qui me fatigue c’est quand je n’arrive pas à rentrer en contact avec un patient. J’ai ma famille, mes amis, le jardinage et la randonnée pour me permettre de décompresser. Nous avons des supervisions, cela nous aide beaucoup de pouvoir partager nos difficultés professionnelles et émotionnelles. J’ai appris à gérer mes émotions, je peux encore être touchée par l’histoire des patients mais je ne me laisse pas atteindre. Apprendre à être soignant c’est travailler avec ce que l’on est : de l’humain à l’humain. Il y a un pied d’égalité car le patient a des émotions au même titre que le soignant. Travailler avec des personnes qui ont commis des violences conjugales ou des actes de pédophilie me demande plus d’effort. Je dois me repositionner en me disant que je travaille avec une personne malade. Mais si vraiment c’est trop difficile, je peux passer la main à un collègue. Nous n’avons que seize patients maximum dans notre unité et nous sommes cinq infirmiers.
Qu’est-ce que votre métier vous apporte ?
Les soins techniques d’infirmière sont toujours les mêmes et il y a peu de place pour la relation. J’étais frustrée au quotidien de ne pas avoir de temps pour l’être humain. J’ai toujours été attirée par la psychiatrie et j’y trouve mon compte car il y a beaucoup de créativité et un vrai rôle de soignant. Il faut être inventif face à chaque individu qui est unique. Je ne m’ennuie jamais. Il y a une grande place pour la communication et la personne.
Mon travail me permet de vivre avec mes valeurs, car je crois que l’accès aux soins doit être pour tous.
Propos recueillis par Elsa Thomasson